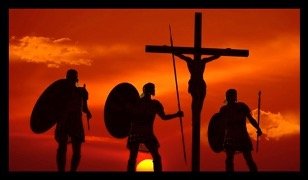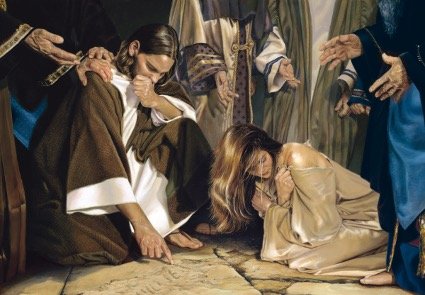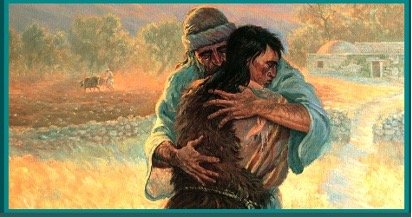Evangile selon Saint Jean 6,1-15:
Après cela, Jésus passa de l’autre côté du lac de Tibériade (appelé aussi mer de Galilée). Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s’assit avec ses disciples. C’était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: «Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger?». Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car lui-même savait bien ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit: «Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain». Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: «Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde!».
Jésus dit: «Faites-les asseoir». Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les leur distribua; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu». Ils les ramassèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d’orge après le repas.
A la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: «C’est vraiment lui le grand Prophète, celui qui vient dans le monde». Mais Jésus savait qu’ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi; alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne.
Un miracle… eucharistique
Luis CASASUS, Président des Missionnaires Identès
Rome, 28 juillet 2024 | XVIIe dimanche du temps ordinaire
2Rois 4, 42-44 ; Ephésiens 4, 1-6 ; Jean 6, 1-15
Chacun de nous a un défaut dominant différent. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en quoi que ce soit pour le comprendre. Mais l’attachement aux jugements et l’attachement aux désirs sont encore plus fondamentaux et universels que n’importe lequel de nos défauts. L’Évangile d’aujourd’hui nous montre à quel point ils sont enracinés dans notre ego. Malgré tous les efforts du Christ, en paroles et en actes, pour rendre visible le Royaume des Cieux, ceux qui l’écoutaient s’obstinaient à voir en lui un futur roi qui les libérerait du pouvoir politique imposé et obtiendrait pour eux la nourriture nécessaire à leur corps.
Il ne s’agit pas simplement d’un fait curieux de notre psychisme, car ses conséquences sont d’ordre spirituel : le texte de l’Évangile nous dit que, Jésus sachant qu’il allait être enlevé pour être fait roi, il se retira de nouveau seul sur la montagne. C’est-à-dire qu’il ne lui a pas été possible de faire les miracles qu’il aurait souhaités dans le cœur de cette foule, de sorte que ce que le Christ nous a annoncé devient vrai et provocateur : Vous ferez plus que moi (Jn 14, 12).
Malgré la myopie de la foule qui entourait le Christ, sa compassion ne les a pas laissés partir. Ils venaient de toutes les couches de la société : des boiteux et des pauvres, des aveugles, mais aussi des gens aisés qui cherchaient un sens à leur vie, des hommes, des femmes et des enfants, chacun avec ses besoins et ses préoccupations personnels. Ils sont venus impressionnés par les miracles que Jésus faisait, pensant qu’il pouvait vraiment les aider. Ils en voulaient plus, c’était une foule affamée, physiquement et spirituellement, mais, comme on pouvait s’y attendre, beaucoup ne s’intéressaient qu’à leurs besoins matériels. Cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, peut-être plus de quinze mille personnes.
Ils n’avaient pas conscience qu’un banquet, même avec du pain et une sardine, et surtout dans leur propre culture, était une image du Royaume de Dieu et de la réconciliation après un conflit, comme celui entre Jacob et Laban :
Le Dieu d’Abraham et le Dieu de Nachor, le Dieu de leurs pères, juge entre nous. Puis Jacob jura par celui que son père Isaac craignait. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et appela ses parents à manger ; ils mangèrent et passèrent la nuit sur la montagne (Genèse 31, 53-54).
Nous devrions tous être conscients que l’attachement aux jugements est une source de désunion, de séparation. Une pensée obsessionnelle ou inutile peut être néfaste, mais un jugement qui nous emprisonne comme un filet nous sépare certainement de notre prochain. Voici quelques exemples typiques dans lesquels beaucoup d’entre nous s’inscrivent :
* J’ai immédiatement besoin de donner mon avis sur une question. Pour ce faire, j’interromps quelqu’un, ou j’écris sans réfléchir un WhatsApp inutile, ou j’adresse une critique destructrice, hâtive et nocive pour ceux qui veulent faire le bien d’une manière différente de ce qui « devrait être » selon mes critères ; comme je l’ai entendu assez souvent : Cette personne se contente d’aider en donnant de l’argent, mais ne donne pas sa vie.
* Je porte un jugement sur quelqu’un : Cette personne X est admirable, pleine de vertus, un vrai saint. Les autres sont vraiment médiocres, ils n’ont pas de talent et ne travaillent pas comme lui. On ne peut pas les traiter avec confiance.
* Si je ne bois pas un café fort avant de commencer à travailler, je n’arrive pas du tout à me concentrer, parce que mon biorythme fonctionne comme ça et les médecins ne peuvent pas comprendre que, bien que je souffre d’hypertension, dans mon cas personnel, le café et le sel sont bons pour moi.
—ooOoo—
Les problèmes de l’humanité aujourd’hui sont colossaux. Non seulement la faim continue d’affliger d’immenses populations, mais la puissance de la technologie dans les guerres modernes, le pouvoir imparable de la drogue et les conséquences des catastrophes naturelles prenne une ampleur chaque fois plus grande. La première lecture relate une période historique de famine épouvantable, décrite dans le deuxième livre des Rois (4, 38-41). Face à ces réalités, nombreux sont ceux qui cèdent à l’impuissance ou au pessimisme.
La mission du Christ n’était pas, et n’est pas aujourd’hui, de résoudre ces problèmes, mais de rendre visible la puissance de la miséricorde de Dieu, au nom de laquelle il a guéri les malades et apaisé la faim de certaines foules. La première lecture raconte également comment la miséricorde divine se manifeste chaque fois que l’un d’entre nous, pécheurs, décide d’obéir à l’inspiration et de faire un geste généreux. Dieu ne fait pas de miracles « à partir de rien ».
Il est curieux de comparer les attitudes de Philippe et d’André. Le premier utilise la logique du monde pour dire : il n’y a rien à faire, la différence entre le nombre de personnes et la quantité de nourriture disponible parlent d’elle-même. Mais André essaie de profiter de la moindre occasion, de la moindre opportunité, représentée par cinq pains et deux poissons. Il n’a aucune idée de la manière dont le Christ va accomplir un miracle qui, dans ce cas, visait apparemment à satisfaire la faim d’une multitude. Dire « apparemment » signifie que tous ces gens ont continué à avoir faim les jours suivants, certains mourant même de malnutrition ; le miracle authentique s’est accompli dans le cœur des disciples, qui ont mieux compris comment la Providence nous donne l’occasion de participer continuellement au plan divin de salut, qui se réalise chaque jour, nous emmenant au-delà de la maladie, du péché, de l’adversité et de la mort.
C’est ce qui est arrivé au garçon qui a mis ses petites réserves de nourriture à la disposition des apôtres. Beaucoup d’entre nous ne croient pas vraiment que Dieu le Père a décidé que sa miséricorde se matérialiserait à travers la matière première de nos actions, si elles sont innocentes et vraiment destinées à servir.
Il y a quelques semaines, je racontais une expérience aux jeunes et aux enseignants de la Jeunesse Idente :
Il y a quelque temps, dans l’une de nos paroisses, à la fin de la messe, un enfant de dix ans s’est approché de moi et m’a demandé de parler un peu à l’écart des autres. Il m’a dit qu’il pensait que l’un des jeunes adultes qui assistaient à la messe était devenu dépendant de la drogue. Je ne l’aurais pas soupçonné et j’ai remercié cet enfant de m’en avoir informé. J’ai donc fait en sorte de parler au jeune homme possiblement tombé dans l’addiction à la drogue. L’enfant ne s’y était pas trompé et, avec l’aide de la grâce, nous avons pu l’aider. Le petit garçon ne pouvait probablement pas imaginer le bien qu’il avait fait, mais le jeune homme a reconnu que Dieu l’avait mis sur son chemin pour l’aider.
Cela nous arrive toujours et c’est peut-être pour cela que nous méprisons les possibles gestes d’amour que nous pouvons faire, pour nous déclarer confortablement et égoïstement « impuissants ». Ce n’est que devant le Christ que nous devons manifester notre impuissance et notre faiblesse, ce qui est une déclaration de foi, que nous sommes pleinement d’accord avec ses paroles : Je suis la vigne, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire (Jn 15, 5).
On raconte l’histoire d’un maître d’école allemand qui, le matin, en entrant dans sa classe, enlevait sa casquette et s’inclinait cérémonieusement devant ses élèves. Quelqu’un lui demanda pourquoi il faisait cela. Il répondit : « On ne sait jamais ce que l’un de ces enfants peut devenir un jour ». Et il avait raison : l’un d’entre eux deviendrait plus tard une figure de proue de la culture allemande. Nous, nous n’avons pas à imaginer une telle chose, car nous savons que chaque enfant de Dieu est appelé à la gloire, et pas seulement à être quelqu’un de plus ou moins important.
—ooOoo—
Comme pour le paralytique que Jésus a guéri (Mt 9, 1-8), quelqu’un, en l’occurrence André, a dû amener l’enfant au Maître. Ce n’est pas un hasard si c’est aussi lui qui a conduit son frère Pierre au Christ.
La question qui s’impose est la suivante : comment puis-je amener quelqu’un au Christ avec confiance ? Bien sûr, il n’y a pas de règles ou de techniques, mais la deuxième lecture contient une phrase bien connue, qui résume non seulement l’attitude personnelle nécessaire, opposée aux attachements susmentionnés aux jugements et aux désirs, mais aussi le témoignage d’une communauté qui sert de chemin humble mais sûr vers la Trinité : Soyez toujours humbles et doux, soyez compréhensifs, vous supportant les uns les autres avec l’amour, vous efforçant de maintenir l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
D’autre part, chacun de nous, en s’avançant pour recevoir l’Eucharistie, porte cette petite graine de foi reçue au Baptême et nous devons croire que Jésus accomplira le miracle que nous venons de mentionner, nous transformant en humbles et aimables, tout en nous donnant la force d’être unis, comme le souligne saint Paul dans cette épître aux Éphésiens, écrite en captivité et destinée à faire prendre conscience de la nécessité de l’unité dans nos communautés, car nous sommes entre les mains d’un Dieu, Père de tous, qui transcende tout, pénètre tout et imprègne tout.
Un fait non négligeable est la déclaration de saint Jean, qui insiste sur le fait qu’ils ont tous mangé à leur faim et qu’il restait douze paniers de pain. Cette « plénitude » représente la plénitude de la vie, l’inutilité de chercher d’autres satisfactions, d’autres consolations que le monde peut offrir. C’est une manière de parler de la liberté à laquelle accède le disciple du Christ, par opposition à la félicité volatile et éphémère que procure la soumission à nos jugements et à nos désirs, à cause desquels nous commettons toujours la même erreur, trompés par notre ego.
Enfin, nous pouvons mentionner que certains biblistes interprètent le miracle non pas comme une « multiplication matérielle », mais comme quelque chose de plus immédiatement spirituel. Selon eux, il était normal que les pèlerins emportent un peu de nourriture pour le voyage, car il s’agissait d’une région inhabitée. L’attitude généreuse du garçon aurait donc déclenché la même générosité chez tout le monde, ce qui semble probable, puisqu’à la fin du récit, il n’est pas fait mention de l’étonnement habituel des foules devant les merveilles accomplies par le Christ. Dans ce cas, en plus de la transformation du cœur des disciples, il y aurait eu un changement, au moins momentané, de toute la foule présente. Cette interprétation est renforcée par le fait qu’il est peu probable que ce soit seulement un enfant qui ait eu la prévoyance d’apporter de la nourriture pour le voyage.
Quoi qu’il en soit, c’est le Christ et Lui seul qui meut la générosité humaine. En tout cas, il est vrai que les enfants sont le modèle tous ceux d’entre nous qui disent vouloir s’identifier à Jésus.
______________________________
Dans les Sacrés Cœurs de Jésus, Marie et Joseph,
Luis CASASUS
Président